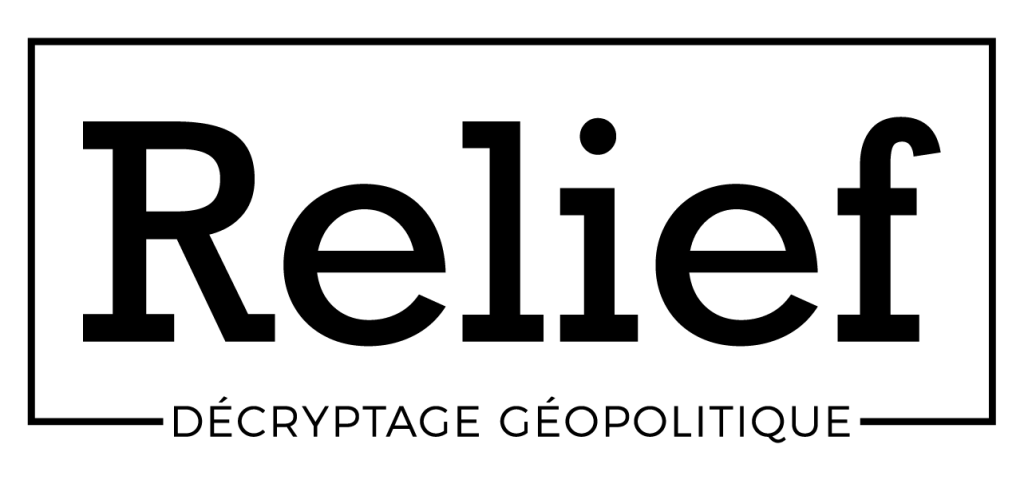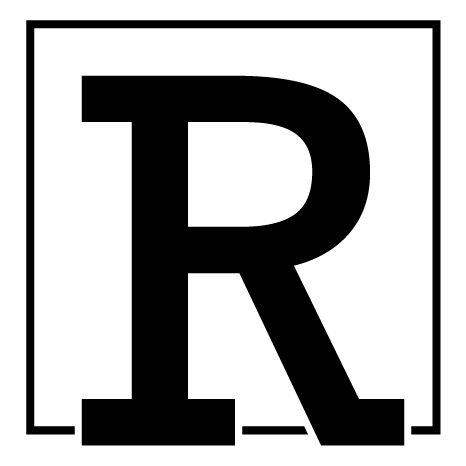La production de Ian Rickson, qui marque la première ouverture à guichets fermés du National Theatre depuis environ dix-huit mois, nous rappelle le don singulier de ce metteur en scène pour la translittération théâtrale et, en fait, la traduction, comme en témoigne la magnifique reprise qu’il a faite au même endroit, il y a quelques années, de la grande œuvre de l’Irlandais Brian Friel, Translations.
Paradise est un spectacle beaucoup plus nébuleux : une relecture sans intervalle, entièrement féminine, de l’histoire du héros militaire Philoctète, qui se voit demander par Ulysse (qu’il déteste) de reprendre le combat afin de réaliser une prophétie sur la victoire de la guerre de Troie. Cette tâche implique de courtiser cet ancien guerrier pour l’éloigner de l’île sur laquelle il a été abandonné pendant une décennie et où il mène une existence sauvage, semblable à celle d’une grotte, plus ou moins solitaire si ce n’est la présence d’un chœur remarquablement individualisé, dont chacun a une vision spécifique de la situation primitive qui se déroule en son sein. Et si la tragédie grecque est l’influence évidente de la Tempête, Tchekhov est également présent, que ce soit dans la prise de conscience Vanya de Philoctète de ce qu’il aurait pu être s’il n’avait pas déraillé à cause de la maladie ou dans la mention en passant de l’abattage d’une mouette : Rickson a en effet réalisé la meilleure production de La Mouette que j’aie vue.
La campagne de marketing rébarbative de Paradise montre une photo en gros plan d’une Lesley Sharp à l’air étiré et angoissé, ici dans le rôle de Philoctète, et une image qui suggère une soirée de théâtre médicinal qui pourrait être bonne pour vous mais qui ne sera pas nécessairement très amusante. En fait, Paradise se révèle beaucoup plus vivant et varié qu’on ne pourrait le croire – impitoyable dans sa critique (exacte) de la fosse septique du monde dans lequel nous vivons (le titre de la pièce est d’une ironie belliqueuse), mais parsemé d’éclats d’humour nécessaires pour détendre l’atmosphère. Ma réplique préférée de l’année théâtrale jusqu’à présent est probablement celle d’Anastasia Hille, dans le rôle d’Ulysse, qui est d’un guttural exaltant, annonçant « Je ne suis pas une putain de pizza » ( !) – en réponse à une discussion sur la présence sur l’île d’ail sauvage, parmi les divers aliments qui maintiennent Philoctète en vie.
Rickson, et c’est tout à son honneur, a trouvé le moyen pour Hille, Sharp et Gloria Obianyo, dans le rôle de Néoptolème, le fils d’Achille, d’embrasser le machisme de leurs rôles sans se laisser piéger par les accents aux dépens du personnage – bien que j’admette avoir été distrait au début par la ressemblance auditive de Sharp avec l’acteur Ray Winstone. Les trois acteurs principaux s’acquittent admirablement de leur tâche dans divers face-à-face qui transforment le décor de Rae Smith, lauréate d’un Tony, en arène de gladiateurs, bien avant que l’on voie l’un de ces hommes uriner sur un autre.
Comme si la langue était en train d’être raclée, Hille abandonne la douceur pour laquelle elle est connue pour situer le nihiliste en Ulysse, qui parle d’un temps où il n’y a « plus rien à combattre ». Et en tant qu’ancienne « bête, machine », Sharp offre une performance exceptionnelle dans le rôle d’une survivante qui a réussi à mener une vie difficile qui n’en vaut peut-être pas la peine, étant donné la sombre réalité du monde en général, telle qu’elle est énumérée dans de nombreux passages dont les résonances modernes ne manquent pas. (Tempest est particulièrement aiguë lorsqu’il s’agit des dirigeants lâches auxquels la société permet aujourd’hui d’accéder au pouvoir, à notre détriment collectif).
Il y a un élément de méta dans les procédures, lorsque l’un ou l’autre personnage choral parle de « s’asseoir et regarder le spectacle », les événements étant encadrés par la présence brûlante et magnifiquement chantée d’ESKA, l’auteur-compositeur-interprète britannique qui est co-compositeur de Paradise aux côtés du lauréat d’un Oscar Stephen Warbeck (Shakespeare in Love). Et parmi un ensemble d’acteurs choriques de premier ordre, il est particulièrement merveilleux de rencontrer Naomi Wirthner, dont la Yasmeen partage avec Philoctète un long baiser prolongé.
Une affection aussi soudaine s’avère l’exception, et non la règle, dans les climats néfastes d’une pièce dont la dystopie inébranlable trouve un écho provocateur dans Jerusalem, l’œuvre maîtresse moderne de Jez Butterworth que ce metteur en scène reprendra dans le West End au printemps prochain. Je ne suis pas sûr que Rickson parvienne à passer la journée, compte tenu de la vision implacable de l’humanité dans les pièces qui l’attirent, bien que l’on puisse souligner une résistance à l’autosuffisance commune à l’emblématique Johnny « Rooster » Byron de Mark Rylance dans Jérusalem et au Philoctète qui ne fait pas de quartier dans Tempest. Mais j’imagine que, quelle que soit la nature impitoyable du paysage présenté, Rickson, comme nous tous, trouve une compensation et une récompense à profusion dans la valeur nourricière de l’art.