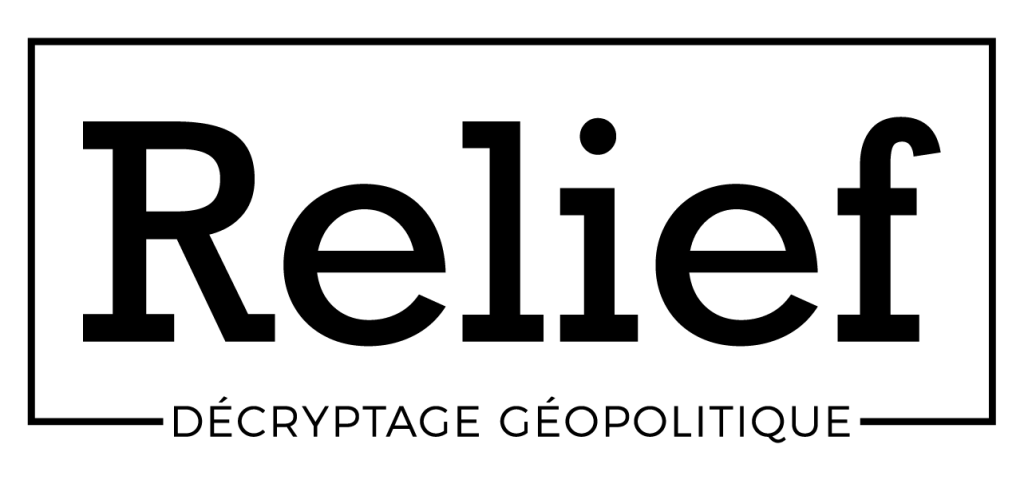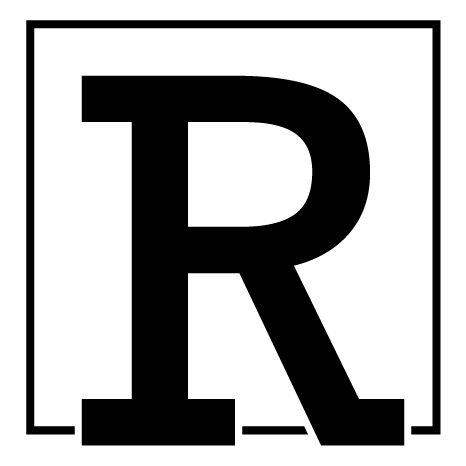Une nouvelle année est en cours, et les théâtres restent fermés aux États-Unis. Les vaccins sont enfin distribués, mais le virus continue de se propager. Face à cette situation incertaine, de nombreux artistes et diffuseurs de danse semblent être dans une situation d’attente – finis les projets de fortune de 2020 mais ne savent pas trop quoi essayer ensuite, si tant est qu’il y en ait.
C’est peut-être ce qui explique le caractère provisoire du festival de danse La MaMa Moves ! de cette année. Celui de l’année dernière, prévu en mai, a été annulé, mais plusieurs des artistes ont été invités à contribuer à un substitut virtuel, des programmes tournants et des discussions d’artistes en streaming sur le site web de La MaMa mardi et mercredi et les 26 et 27 janvier. Solos, courtes vidéos et travaux en cours donnent une image du moment : pas grand chose de fini ou de substantiel, mais des éclairs de promesse tout autour.
Le « Body Concert » de Kevin Augustine, en premier lieu, est en cours de réalisation. Directeur artistique de Lone Wolf Tribe, Augustine est un marionnettiste talentueux et un fabricant de marionnettes. Son dernier projet concerne des parties du corps en caoutchouc mousse – mains, jambes, yeux, tous sans peau comme des modèles anatomiques en chair – qu’il manipule dans un costume noir et un masque couvrant le visage. Plutôt que de présenter ce projet sous forme de vidéo, il nous donne une sorte de « making of » publicitaire pour celui-ci.
De nombreux fragments de la représentation résonnent de façon troublante. Il y a quelque chose de tendre et de dérangeant à regarder des doigts attachés à un bras écorché palper une jambe écorchée, surtout lorsque les os exposés se touchent comme des fronts pressés l’un contre l’autre. Mais les discussions en coulisses, ainsi que les rappels inutiles de la difficulté des circonstances actuelles, continuent d’étouffer l’illusion. C’est un teaser de 30 minutes.
Le film d’Anabella Lenzu, « La nuit où vous avez cessé de jouer », tout aussi discursif, dérange d’une autre manière. S’adressant directement à la caméra, Lenzu partage sa musique préférée et des morceaux de vieilles danses, exécutés dans le présent avec des images de son jeune moi par-dessus son épaule. Elle fait une blague sur le fait qu’Alexa, l’assistante virtuelle, ne comprend pas son accent argentin. Elle fait allusion à la dictature en Argentine et à l’histoire des disparitions de personnes. Ce qui domine, cependant, c’est son personnage satisfait de lui-même, qui éclate en sourcils battus et en sourires fous. La vidéo semble être, par inadvertance, le portrait de quelqu’un qui ne peut pas s’arrêter de jouer. Est-ce une réponse à l’époque ou est-elle toujours comme ça ?
WATCHING : Recommandations sur les meilleures émissions de télévision et les meilleurs films à regarder et à diffuser en continu.
S’inscrire
Les sélections les plus centrées sur la danse proviennent du chorégraphe norvégien Kari Hoaas. Au lieu de présenter une œuvre complète, elle a adapté une œuvre précédente, « Heat », en plusieurs brefs solos qu’elle appelle « haïkus de danse ». Tournés en prises uniques dans des lieux visuellement saisissants – un ancien aéroport d’Oslo, converti en bureaux désormais vides ; un parking avec une flaque d’eau qui fait office de bassin de réflexion – les films sont chacun intitulés d’un seul mot et témoignent d’une économie de type haïku.
Ou presque. Largement composés de mouvements lents et froissants, les morceaux ont tendance à bien se terminer : Le danseur de « Grow », encadré dans un escalier, descend finalement du cadre comme dans l’eau en dessous ; le danseur de « Lot », qui a pataugé sur un sol plat comme sur une corde raide, en ressort avec une jambe de bois. Pourtant, l’action essentielle de chaque pièce est diluée, ou pas assez forte pour résonner par réduction.
« The Yamanakas at Home », de Tamar Rogoff et Mei Yamanaka, est un autre travail en cours, mais présenté sans explication. C’est un film calme de 10 minutes sur un couple japonais hanté par une silhouette en tenue de camouflage. Bien que les plans de cette figure dans les escaliers me rappellent l’effrayant Bob dans « Twin Peaks », l’impression finale est celle d’un esprit plus bénin, celui qui apparemment veut juste descendre et danser.
C’est un désir partagé par le protagoniste de l’autre contribution de Rogoff, « Wonder About Merri », un court métrage de 2019 qui sert de coda d’inspiration pour le festival. Merri Milwe souffre de dystonie, un trouble neurologique caractérisé par des spasmes involontaires. Nous l’apprenons, utilement pour nous si c’est peu plausible pour elle, lorsqu’elle consulte son état dans le dictionnaire.
À la fin du film de cinq minutes, après que Merri ait répondu à la musique d’une voiture en se levant de son fauteuil roulant et en dansant sur le trottoir, un épisode que le film traite comme un miracle, elle raye la définition et écrit une réplique : « Alors pourquoi je peux danser ? »
Sans plus d’explication, la question se sent un peu forcée. Qui a dit qu’elle ne pouvait pas ? Mais la réponse implicite est une réponse que seuls les danseurs pourraient utiliser pour entendre. Tout comme une condition ne définit pas une personne, Merri semble le montrer, de sorte que les circonstances ne peuvent pas complètement confiner un esprit de danse.