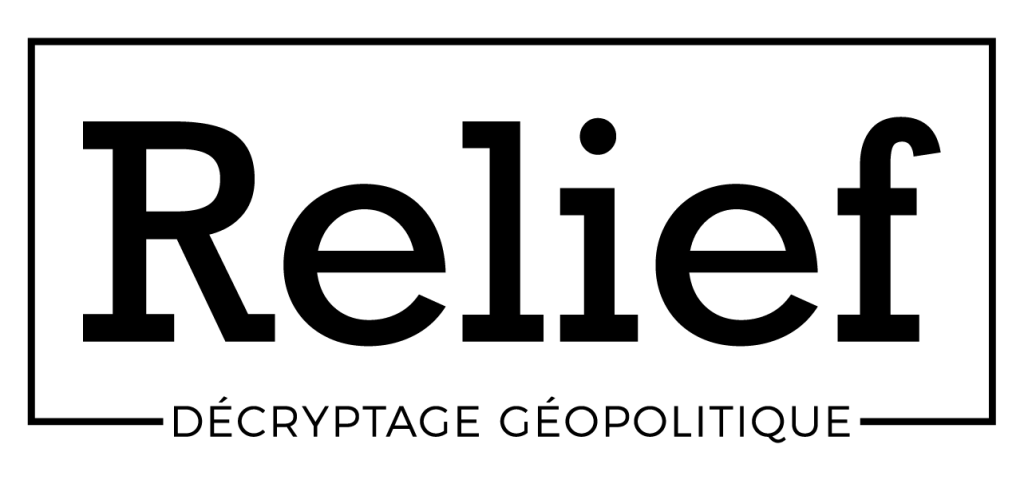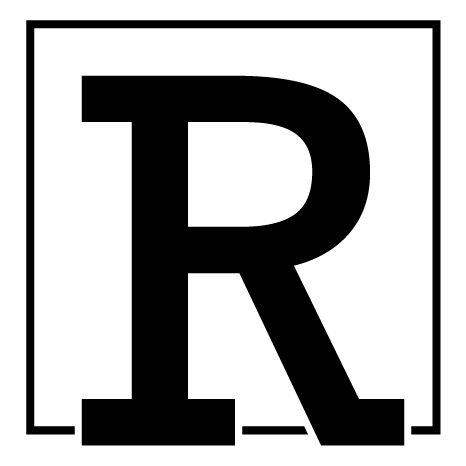La rencontre du 21 janvier entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov et son homologue américain Antony Blinken fait suite aux entretiens intensifs de la semaine précédente : le premier cycle du dialogue américano-russe sur les questions de sécurité européenne à Genève, suivi des sessions du Conseil Russie-OTAN à Bruxelles et du Comité permanent de l’OSCE à Vienne. Les discussions extrêmement difficiles qui se sont déroulées la semaine dernière en Europe n’ont pas débouché sur un scandale public ou une rupture définitive, mais elles n’ont pas non plus inspiré la confiance dans une résolution prochaine de la crise actuelle de la sécurité européenne.
L’absence de solution diplomatique conduira logiquement à une nouvelle escalade de la crise et augmentera les chances que la seule façon d’en sortir soit d’utiliser ce que les responsables russes appellent des « moyens militaro-techniques. » Tandis que Moscou et Washington continuent d’évaluer la situation et se préparent à prendre de nouvelles mesures, il est logique d’explorer les racines de la crise, d’analyser les voies et les conséquences de son escalade et d’envisager d’autres moyens de résoudre le problème de sécurité à l’est de l’Europe.
Racines
Les racines de la crise peuvent être clairement retracées. Avec la fin de la guerre froide et l’effondrement de l’Union soviétique, les États-Unis et leurs alliés ont établi un ordre européen fondé sur le rôle dominant de l’Amérique et la position centrale de l’OTAN en tant qu’instrument de régulation militaire et politique, et de garantie de la sécurité occidentale et de l’ordre qu’ils avaient créé. La Russie, qui n’a pas réussi à s’intégrer à l’Occident à ses propres conditions et qui a refusé d’accepter le rôle inférieur qui lui était proposé, s’est retrouvée en dehors de cet ordre et a été contrainte d’accepter le nouvel état de choses. Les États-Unis savaient que la Russie était mécontente de la situation, mais préféraient l’ignorer, car ils considéraient le pays comme une puissance en déclin.
L’histoire a toutefois montré que si une grande puissance vaincue n’a pas été intégrée dans l’ordre de l’après-guerre, ou si on ne lui a pas offert une place qu’elle juge acceptable, elle commencera avec le temps à prendre des mesures visant à détruire cet ordre ou, à tout le moins, à le modifier de manière significative. Cela dépend, bien sûr, du fait que la puissance frustrée dispose d’un potentiel matériel suffisant et que ses dirigeants aient la volonté politique et le soutien du public. En Russie, ces conditions ont commencé à se former dans la première moitié des années 2010, comme en témoigne la réaction de Moscou à la crise en Ukraine, ainsi que la confrontation avec les États-Unis et la rupture des relations avec l’UE qui ont suivi.
Évolution de la confrontation
Au cours des huit années de la confrontation avec l’Occident, la politique étrangère de la Russie a continué d’évoluer, passant de l’adaptation à de nouvelles réalités incommodes à des tentatives pour au moins empêcher la position géopolitique du pays de se détériorer davantage, et au mieux pour changer la situation à l’avantage de la Russie. Pourtant, jusqu’au début de l’année 2021, cette politique s’est essentiellement appuyée sur celle de Mikhaïl Gorbatchev dans le sens où elle cherchait à atteindre une compréhension mutuelle – et à établir des relations de partenariat – avec les États-Unis et l’Europe. Jusqu’à très récemment, le président Vladimir Poutine passait beaucoup de temps, au cours de longues discussions télévisées avec des intervieweurs américains, à essayer de convaincre le public américain que les intérêts russes ne sont pas contraires à ceux des États-Unis, et que Moscou et Washington peuvent et doivent unir leurs forces contre les défis mondiaux tels que la sécurité universelle, les menaces terroristes ou la pandémie.
Cette attitude a changé au début de l’année 2021. Ce printemps-là, les troupes russes ont commencé des exercices militaires à grande échelle le long de la frontière ukrainienne. Les services de renseignement américains ont soupçonné que ces exercices pouvaient servir de couverture aux préparatifs d’invasion de l’Ukraine. Incapable d’ignorer les actions de la Russie, le président américain Joe Biden a invité Poutine à le rencontrer à Genève, alors que la Russie ne figurait pas auparavant parmi les priorités de la Maison-Blanche.
Cette tactique consistant à forcer Washington à engager des discussions avec Moscou a en fait été exprimée par Poutine dès 2018, dans un discours devant les deux chambres du parlement russe. Présentant une gamme de nouveaux systèmes d’armes, le président russe a déclaré à propos des États-Unis : « Personne ne nous écoutait avant. Eh bien, écoutez-nous maintenant. »
Les seuls résultats concrets de la rencontre des deux présidents à Genève ont été le début de consultations russo-américaines sur la stabilité stratégique et la cybersécurité. Toutefois, en ce qui concerne l’Ukraine, le processus de Minsk visant à mettre fin au conflit s’est retrouvé dans une impasse diplomatique, alors même que l’OTAN a augmenté l’ampleur et la fréquence de ses exercices militaires dans la région de la mer Noire. En fait, la situation aux frontières ouest et sud-ouest de la Russie n’a fait que s’aggraver.
La situation a contraint le Kremlin à revenir à sa tactique consistant à utiliser la force pour faire pression sur la Maison Blanche. À la fin de l’automne 2021, les services de renseignement américains ont signalé une menace croissante à la frontière entre la Russie et l’Ukraine. Un renforcement militaire des forces russes encore plus important que celui observé au printemps a contraint Washington à aller encore plus loin que les pourparlers directs, et à accepter de négocier avec Moscou sur les questions de sécurité européenne.
Négociations forcées
À cet égard, la tactique de la Russie consistant à forcer les États-Unis à s’asseoir à la table des négociations a fonctionné. Aussi, forte de ce premier succès, Moscou a présenté aux Américains et à leurs alliés un projet de traité et d’accord exposant les exigences de la Russie vis-à-vis de l’Occident sur la question de la sécurité européenne.
Les pourparlers de la semaine dernière n’ont pas débouché sur une percée, et ils ne pourraient d’ailleurs pas le faire. Il est peu probable que le Kremlin lui-même s’attendait à ce que ses exigences soient acceptées. Le type de conditions avancées par la Russie n’est généralement mis en œuvre que par le camp des perdants, ce qui n’est pas le cas des États-Unis.
Le plus important est que, pour la première fois depuis les pourparlers sur la réunification allemande, les États-Unis se sont assis à la table des négociations avec la Russie pour discuter des problèmes de sécurité européenne. De plus, pour la première fois depuis son récent retrait du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), Washington a montré sa volonté de parvenir à un accord sur le non-déploiement de missiles à courte et moyenne portée en Europe, ainsi que sur la restriction de l’activité militaire en Europe de l’Est.
Il n’y a pas si longtemps, Moscou aurait considéré cela comme une victoire diplomatique majeure. Aujourd’hui, cependant, la barre a été placée beaucoup plus haut. La Russie a insisté pour que les pourparlers se concentrent sur ses exigences « contraignantes » : ne pas étendre l’OTAN aux anciens pays soviétiques, ne pas positionner en Europe des systèmes d’armes offensifs susceptibles d’atteindre le territoire russe, et retirer les infrastructures militaires établies par l’OTAN en Europe de l’Est depuis la signature de l’Acte fondateur sur les relations avec la Russie en 1997.
Garanties de sécurité
À proprement parler, il ne peut y avoir qu’une seule garantie de sécurité à l’ère nucléaire, à savoir la menace de destruction mutuelle assurée. Celle-ci a cependant ses inconvénients : en cas de conflit armé entre puissances nucléaires, la partie perdante peut recourir aux armes nucléaires pour éviter d’être vaincue, ouvrant ainsi la voie à une escalade qui pourrait conduire à un échange de frappes nucléaires massives et à la mort de la civilisation.
Toutes les autres garanties sont conditionnelles et ne peuvent être invoquées. Les mesures de contrôle et de réduction des armements, les efforts de non-prolifération, les mesures de confiance et la transparence, les moratoires, la retenue réciproque ou multilatérale, etc. visent tous à accroître la prévisibilité mutuelle et à faire en sorte que les décisions militaires et politiques soient prises à tête reposée. Néanmoins, aucun traité juridiquement contraignant ou accord politiquement contraignant ne peut offrir de garantie absolue quant à sa mise en œuvre.
Les relations internationales reposent sur le principe et, pour les acteurs indépendants, sur la réalité de la souveraineté des États. Les nations ne se contentent pas de conclure librement des accords entre elles, elles sont également libres d’y mettre fin. Rien qu’au cours des vingt dernières années, les États-Unis se sont retirés unilatéralement des accords américano-russes sur les systèmes de défense antimissile et les missiles à portée intermédiaire, du traité multilatéral « ciel ouvert » et de l’accord sur le nucléaire iranien. Les garanties en béton n’existent tout simplement pas.
Il n’y a aucune illusion à ce sujet au Kremlin et au ministère des Affaires étrangères, et encore moins dans les quartiers généraux militaires. Il n’existe aucune confiance réelle dans les pactes de non-agression ou les accords de détachement (ou de ciblage zéro). Compte tenu de la situation politique intérieure actuelle des États-Unis, il est pratiquement impossible de conclure avec ce pays un quelconque accord qui serait ratifié par les deux tiers des sénateurs américains. Poutine lui-même l’a reconnu lorsqu’il a déclaré publiquement qu’il voulait voir « au moins des accords juridiquement contraignants ».
Il est possible qu’il s’agisse d’une tentative de Poutine de rattraper l’oubli de Gorbatchev, qui n’a pas réussi à obtenir des engagements juridiquement contraignants pour ne pas étendre l’OTAN après la réunification allemande. Ces derniers temps, cette question est redevenue un sujet très discuté parmi les responsables et les médias russes.
Il existe toutefois une façon plus large d’envisager la question. Sur les cinq dernières vagues d’expansion de l’OTAN, quatre se sont produites sous l’œil de Poutine : les pays baltes, la Slovaquie, la Slovénie, la Roumanie et la Bulgarie en 2004 ; la Croatie et l’Albanie en 2009 ; le Monténégro en 2017 ; et la Macédoine du Nord en 2020. Pendant longtemps, Moscou n’avait aucun moyen de résister à ce processus : elle n’avait ni l’influence suffisante dans les pays en question, ni les moyens de faire pression sur eux. Aujourd’hui, il semble avoir acquis ces moyens, et Poutine – qui semble se sentir un peu responsable de ce qui s’est passé pendant son long règne – commence à utiliser ces moyens pour faire amende honorable. La question est de savoir s’il est réaliste pour les Américains et les Européens de mettre en œuvre les exigences de la Russie.
Les limites du possible
La politique, comme le dit le proverbe, est l’art du possible. Au centre du projet de traité russe se trouvent trois exigences inconditionnelles de Moscou : la fin de l’expansion de l’OTAN, l’arrêt du déploiement des infrastructures de l’OTAN – en particulier des armes offensives – en Europe et le retrait des infrastructures militaires déployées en Europe de l’Est après 1997.
La principale exigence de Moscou – pas de nouvelle expansion de l’OTAN sur le territoire de l’ancienne Union soviétique – est de facto mise en œuvre, puisque les États-Unis et leurs alliés ne sont pas prêts à assumer la responsabilité de la défense militaire de leurs clients, l’Ukraine et la Géorgie, et il est peu probable que cela change. Le problème n’est pas tant les conflits non résolus en Abkhazie, en Ossétie du Sud et dans le Donbas que la perspective d’une confrontation directe avec la Russie dans des endroits où Moscou a de véritables intérêts en matière de sécurité et est prête à utiliser la force pour les protéger si nécessaire. Les États-Unis, quant à eux, n’ont pas de tels intérêts et ne sont pas prêts à utiliser la force, et il est peu probable que cela change.
Comme les États-Unis ne sont pas prêts à faire la guerre à la Russie pour l’Ukraine, ni l’Ukraine ni la Géorgie ne seront acceptées dans l’OTAN tant que la Russie sera en mesure de l’empêcher. La menace d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN est donc en fait une menace fantôme dans un avenir prévisible. La question de savoir si nous pourrions voir l’OTAN en Ukraine, sous la forme d’armes offensives, de bases militaires, de conseillers militaires, de fournitures d’armes, etc. est plus délicate. Avoir ce qui équivaudrait à un porte-avions insubmersible contrôlé par les États-Unis aux portes de Moscou, en territoire hostile, même si l’Ukraine ne fait pas officiellement partie de l’OTAN, serait bien plus grave que l’adhésion des pays baltes à l’OTAN. Il ne s’agit pas encore d’une menace à part entière, mais elle pourrait certainement le devenir, et que se passera-t-il alors ?
Il y a une chance qu’un accord puisse être trouvé sur la question de la non-implantation de stations de missiles américaines en Ukraine, comme en témoigne la volonté des négociateurs américains de discuter de ce sujet à Genève. L’établissement de bases de missiles n’est pas une priorité militaire pour Washington, et leur apparition hypothétique autour, disons, de la région de Kharkiv en Ukraine pourrait être contrée en équipant les sous-marins russes qui longent le continent américain de missiles hypersoniques Zirkon (Tsirkon).
Il est également possible qu’un accord soit conclu sur les bases militaires des États-Unis et des autres membres de l’OTAN en Ukraine. À l’heure actuelle, les pays occidentaux souhaitent éviter de subir des pertes lors d’éventuels combats entre la Russie et l’Ukraine, et prévoient donc actuellement d’évacuer leurs conseillers du pays.
Il sera plus difficile, voire impossible, de s’entendre sur la fin de la coopération militaire et militaro-technologique entre l’Ukraine et les États-Unis/l’OTAN. Le mieux que l’on puisse espérer ici est une restriction de la nature des armes fournies à Kiev par l’Occident. Pour que cela se produise, les États-Unis insisteront sur une désescalade des préparatifs militaires russes aux frontières de l’Ukraine. Toute désescalade devra toutefois s’accompagner de restrictions sur les manœuvres de l’OTAN à proximité des frontières russes en Europe.
La demande de Moscou de retirer toute l’infrastructure militaire déployée dans les États membres de l’OTAN en Europe de l’Est est aussi impossible qu’elle est largement inutile en termes de sécurité pour la Russie. Les quelques milliers de soldats américains situés sur le territoire en question ne constituent pas exactement une menace sérieuse pour la Russie. Les bataillons de l’OTAN présents dans les pays baltes ne sont là que pour apaiser les trois pays hôtes : leur présence sur l’ancien territoire soviétique peut laisser un mauvais goût à Moscou, mais elle n’est guère alarmante.
Il existe bien sûr d’autres infrastructures qui constituent une véritable menace : tout d’abord, les composants de la défense antimissile américaine en Roumanie et en Pologne, les bases aériennes qui pourraient accueillir des avions capables de transporter des armes nucléaires, les bases navales, etc. La question des lanceurs de systèmes de défense antimissile qui pourraient être adaptés aux missiles de portée intermédiaire pourrait être résolue dans le cadre d’un nouvel accord sur les FNI. D’autres questions relèvent de la maîtrise régulière des armements en Europe, qui a été mise en veilleuse depuis que les pays de l’OTAN ont refusé de ratifier le traité adapté sur les forces conventionnelles en Europe.
On soupçonne que la troisième demande clé – en fait, un retour à 1997 – a été présentée pour pouvoir être retirée plus tard, démontrant ainsi que Moscou est prêt à faire des compromis. La séparation de l’ensemble des propositions et des exigences de la Russie, ainsi que la volonté de suivre des voies parallèles, pourraient offrir davantage de possibilités de parvenir à des accords, mais uniquement si l’on est convaincu que des accords satisfaisant les intérêts de la Russie en matière de sécurité peuvent être conclus.
Et ensuite ?
Les chances de voir les États-Unis mettre en œuvre les exigences de la Russie dans le format et le calendrier fixés par Moscou sont inexistantes. Des accords sont théoriquement possibles sur deux des trois questions clés : la non-expansion et le non-déploiement. Mais tout accord de ce type sera de nature politique et non juridiquement contraignant.
Divers commentateurs russes ont évoqué la possibilité de revenir sur les dispositions de la déclaration du sommet de Bucarest de 2008, qui stipulait que l’Ukraine et la Géorgie « deviendront membres de l’OTAN ». Il est toutefois peu probable que cela se produise lors du sommet de l’alliance qui se tiendra à Madrid cette année : ce symbolisme n’a peut-être aucune substance réelle, mais y renoncer serait probablement une trop grande perte de face pour les États-Unis et l’OTAN.
Ce n’est toutefois pas la seule option. L’OTAN pourrait, à l’initiative des États-Unis, annoncer un moratoire à long terme sur les nouveaux membres, par exemple. M. Biden a déjà déclaré qu’il était peu probable que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN soit approuvée au cours de la prochaine décennie, tandis que certains experts américains parlent de vingt à vingt-cinq ans. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a été plus précis dans le choix de ses mots : « jamais au grand jamais ». Pour la grande majorité des hommes politiques et des fonctionnaires d’aujourd’hui, cependant, « jamais » pourrait bien signifier « pas de mon vivant ». Un chiffre de soixante-neuf ou même quarante-neuf ans ferait tout aussi bien l’affaire.
Il est également possible de se mettre d’accord sur le non-déploiement de missiles à portée intermédiaire et d’autres armes offensives : non pas dans le cadre d’un traité, mais d’un accord intergouvernemental entre la Russie et les États-Unis, qui n’aurait pas à être ratifié par ces derniers. Il serait également possible, au cours des négociations sur la question, de répondre aux préoccupations des deux parties concernant, respectivement, les lanceurs de défense antimissile américains et les nouveaux missiles de croisière russes.
Enfin, il serait possible de sélectionner des domaines spécifiques de préoccupation concernant les infrastructures sur le flanc oriental de l’OTAN et de les résoudre par des mesures de confiance.
Aucune des mesures décrites ci-dessus ne comporte de garanties de sécurité ou de documents juridiquement contraignants, mais, comme on l’a noté précédemment, la Russie dispose depuis longtemps des premières grâce à son arsenal nucléaire et à ses forces armées, tandis que les secondes sont effectivement impossibles et ne seraient de toute façon pas absolues. Néanmoins, elles fourniraient au moins à la Russie des assurances écrites.
Contre-mesures
Pour l’instant, aucun accord n’est en vue sur les questions qui préoccupent la Russie. Pour le président Poutine, cependant, un résultat négatif compte aussi comme un résultat. Le Kremlin avait besoin de s’exprimer en toute clarté sur ses préoccupations en matière de sécurité en Europe, et il s’est montré très clair.
Il est important de comprendre que les exigences de Moscou vis-à-vis des États-Unis et de l’OTAN sont en fait les objectifs stratégiques de la politique russe en Europe. Leur but n’est pas de restaurer l’Union soviétique, comme certains le suggèrent. L’idée est plutôt de recadrer la sécurité en Europe – en particulier à l’est de l’Europe – comme une relation contractuelle entre les deux principaux acteurs stratégiques de la région, la Russie et les États-Unis/OTAN, tournant ainsi la page d’une époque où elle était l’affaire des seuls États-Unis. Cet objectif est considéré comme un intérêt vital pour la sécurité nationale. Si la Russie ne peut atteindre son objectif par des moyens diplomatiques, elle devra recourir à d’autres outils et méthodes.
Les responsables russes ont déclaré que si les pourparlers échouent, Moscou prendra des mesures militaro-techniques, voire militaires. Ces mesures n’ont pas été précisées à l’avance – contrairement aux sanctions occidentales qui ont été menacées en cas d’invasion du territoire ukrainien par la Russie – mais elles sont largement discutées. Un éventail de mesures est susceptible d’être proposé à Poutine par ses conseillers, allant du maintien de la pression avec la menace de la force et le déploiement de nouveaux systèmes d’armes dans les régions sensibles, à une coopération beaucoup plus étroite avec l’allié russe, le Belarus, et les partenaires chinois.
Il est toutefois important que ces mesures soient une réponse aux menaces existantes et futures probables pour la sécurité de la Russie, plutôt qu’une provocation qui susciterait de nouvelles menaces. Il ne sert à rien de chercher à punir l’Occident pour son intransigeance en utilisant la technologie ou la stratégie militaire. L’essentiel pour Moscou est de maintenir une solide politique de dissuasion dans toutes les conditions militaires, technologiques et géopolitiques imaginables. Des garanties crédibles de sécurité nationale ne reposent pas sur des pactes de non-agression avec un ennemi potentiel, mais sur une dissuasion efficace de tout adversaire.
Néanmoins, les accords peuvent également être utiles, si les conditions sont acceptables. La récente vague de négociations n’est qu’une manche du jeu stratégique complexe qui se joue actuellement sous les yeux du monde. Les États-Unis et l’OTAN ont promis de présenter à la Russie leurs propres contre-propositions (lire : contre-demandes). Dans les coulisses, le Congrès américain discute de nouvelles sanctions, le Kremlin élabore une série de contre-sanctions et le ministère russe de la défense effectue un exercice conjoint avec les forces armées biélorusses. Les relations entre grandes puissances restent essentiellement un jeu de pouvoir.