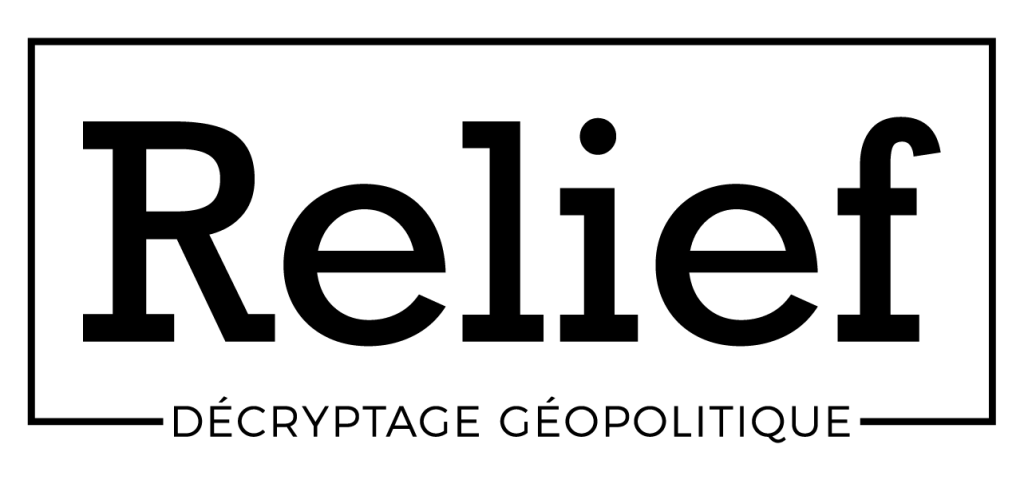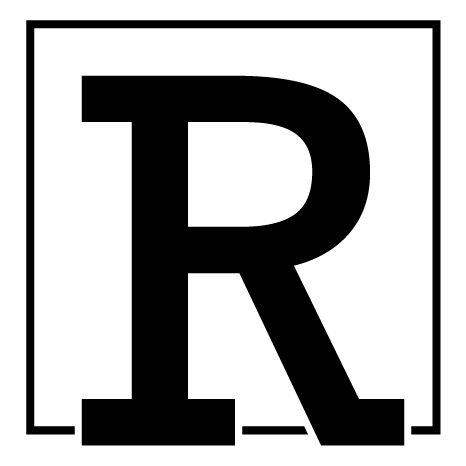Le romancier et dramaturge Damon Galgut, 58 ans, a grandi à Pretoria, en Afrique du Sud, au plus fort de l’apartheid. Il a écrit son premier roman à 17 ans et a été deux fois sélectionné pour le prix Booker. Son dernier, The Promise, s’étend sur quatre décennies tumultueuses et retrace l’après-vie d’une matriarche blanche qui souhaitait léguer ses biens à sa servante noire. Ce roman est fortement pressenti pour lui valoir une place sur la liste des finalistes de cette année, qui sera annoncée le 14 septembre. Il vit à Cape Town.
Propos recueillis par Adrien Maxilaris pour Relief
Relief : Comment The Promise a-t-il vu le jour ?
Damon Galgut : Les livres ont tendance à se construire à partir de groupes d’idées ou de thèmes que l’on transporte pendant un certain temps et dont on s’inquiète. La forme spécifique de ce livre s’est cristallisée autour d’une série d’anecdotes qu’un ami m’a racontées lors d’un déjeuner un peu trop arrosé, à propos de quatre enterrements familiaux auxquels il avait assisté. Je me suis dit que ce serait une façon intéressante de raconter l’histoire d’une famille en particulier. La promesse elle-même est également venue d’un ami, qui me racontait comment sa mère avait demandé à la famille de donner un certain terrain à la femme noire qui l’avait soignée pendant sa dernière maladie, comme cela se passe dans le livre.
Pourquoi le situer à Pretoria ?
C’était une façon d’exorciser une partie de mon éducation. Pretoria, dans les années 1960, 1970 et 1980, n’était pas un endroit où il faisait bon grandir, même selon les normes sud-africaines. C’était le centre névralgique de toute la machine de l’apartheid et il y régnait une mentalité chrétienne conservatrice, ainsi qu’une violence sous-jacente très mémorable.
Les Swart, la famille de La Promesse, sont-ils basés sur votre propre histoire ?
Pas spécifiquement, bien que de petites anecdotes y soient mélangées, et il y a un côté juif dans ma famille, un côté afrikaner calviniste. On ne peut pas vraiment créer des personnages sans s’inspirer d’un aspect de soi-même, donc tout cela est en quelque sorte un reflet de ma propre nature.
Le roman a un style narratif distinctif. Comment cela a-t-il évolué ?
J’ai commencé et je n’étais pas satisfait, puis j’ai participé à l’écriture d’un scénario de film, ce qui a eu un effet formateur, car lorsque je suis revenu au livre, il semblait très statique. J’y ai vu un moyen d’introduire une partie de la logique narrative du cinéma. La personnalité du narrateur change également – c’est un élément qui, je l’espère, pousse légèrement le lecteur à se poser la question : qui raconte l’histoire ? Et le fait que cette question soit posée est peut-être son seul intérêt.
Lincoln in the Bardo de George Saunders m’a fait sortir de mon pantalon.
Qu’est-ce qui a fait de vous un écrivain ?
Il y a une forte tendance juridique dans ma famille et j’ai subi pas mal de pressions pour m’orienter dans cette voie quand j’étais plus jeune, mais c’est à peu près ce que j’ai toujours voulu faire. J’ai eu un lymphome quand j’étais petite et, à cette époque, beaucoup de relations m’ont fait la lecture, et j’ai appris à associer les livres et les histoires à un certain type d’attention et de réconfort. Les livres peuvent encore me transporter dans un autre endroit, ce qui est leur raison d’être, je pense.
Comment avez-vous négocié les attentes en matière d’engagement politique qui accompagnent le fait d’être un écrivain sud-africain ?
Les critiques de mes premières œuvres ont estimé que j’étais un enfant de privilégiés et que j’avais le luxe d’ignorer la situation de l’Afrique du Sud. Je me souviens avoir été très affecté par cette observation, car d’une certaine manière, je savais que c’était vrai. Pour moi, l’attrait de la fiction ne réside pas seulement dans le fait qu’elle éclaire l’histoire, mais aussi dans le fait qu’elle peut vous dire ce que l’on ressent en tant qu’être humain au sein de l’histoire, et c’est donc un défi que d’essayer d’orienter l’œuvre au bon endroit.
Avez-vous une routine d’écriture stricte ?
Je suis sans espoir, je suis un désordre. Il faut que j’atteigne le stade où je suis suffisamment obsédé pour que l’œuvre m’appelle à la première heure et ne me lâche plus. Je finis par y arriver, mais cela prend beaucoup de temps, et avec un premier jet et tout ce qui est trouble – j’ai l’impression d’avoir une forme dans la boue, que j’essaie de remonter – je préfère faire presque n’importe quoi plutôt que d’écrire. Cela a tendance à être très bon pour les tâches ménagères.
J’ai entendu dire que vous écriviez à main levée.
Je suis un peu fétichiste de la papeterie. J’ai un stylo plume particulier avec lequel je travaille depuis que j’ai 20 ans environ – c’est un Parker, en écaille de tortue. Et puis j’aime beaucoup ces carnets rouges qui sont monnaie courante en Inde. Pour une raison ou une autre, ils excitent ma sensibilité en matière de papeterie, alors je les remplis de débuts pour la plupart inutiles et, de temps en temps, une idée prend feu. Ce n’est qu’après deux brouillons complets que je m’assois pour la mettre sur l’ordinateur.
Quel est l’aspect le plus agréable de l’écriture ?
Parfois, vous avez l’impression d’avoir ouvert une porte et qu’une histoire s’y trouve, si vous pouvez la suivre phrase par phrase, mais la plupart du temps, le vrai plaisir ne vient que vers la fin, lorsque vous rassemblez tout et qu’il y a une certaine clarté.
Comment le fait d’avoir été deux fois finaliste du prix Booker a-t-il affecté votre carrière ?
Cela a vraiment changé mes perspectives d’avenir d’une manière que presque rien d’autre n’aurait pu faire. Cela dit, les listes de prix sont problématiques à bien des égards et il y a une telle frénésie autour de ce prix particulier que l’on se sent presque coupable d’en bénéficier. Je ne supporte pas très bien les grands événements publics ou une trop grande attention, et les deux présélections m’ont probablement fait perdre quelques années.
Est-ce que ce sera plus facile la troisième fois ?
C’est une question de loterie. Cependant, si la loterie me favorisait à nouveau, je pense que je deviendrais peut-être un peu plus sensible et philosophe. Le Booker vous joue un vilain petit tour à la toute fin : pendant quelques semaines, vous êtes l’un des six gagnants, puis toute cette attention s’envole et très, très soudainement, il n’y a plus qu’un seul gagnant, les autres sont des perdants
Quel est le dernier grand livre que vous avez lu ?
Lincoln in the Bardo de George Saunders est le dernier livre qui m’a vraiment donné l’impression de m’extraire de mon pantalon. Je l’ai trouvé tellement inhabituel et radical dans son inspiration. Qui pourrait inventer un tel livre
Quels sont les écrivains vivants que vous admirez le plus ?
Une fois, j’ai fait un pèlerinage dans la maison de Cormac McCarthy, à El Paso. C’était avant la parution de All the Pretty Horses et il était si peu connu que même les dames de la bibliothèque publique d’El Paso ne savaient pas qui il était. Je n’ai pas eu le courage de frapper à sa porte. Je me suis battu avec moi-même, mais je me suis dit : est-ce que je préfère avoir le souvenir d’être assis devant la maison de Cormac McCarthy ou celui d’avoir été chassé de sa porte par lui ?