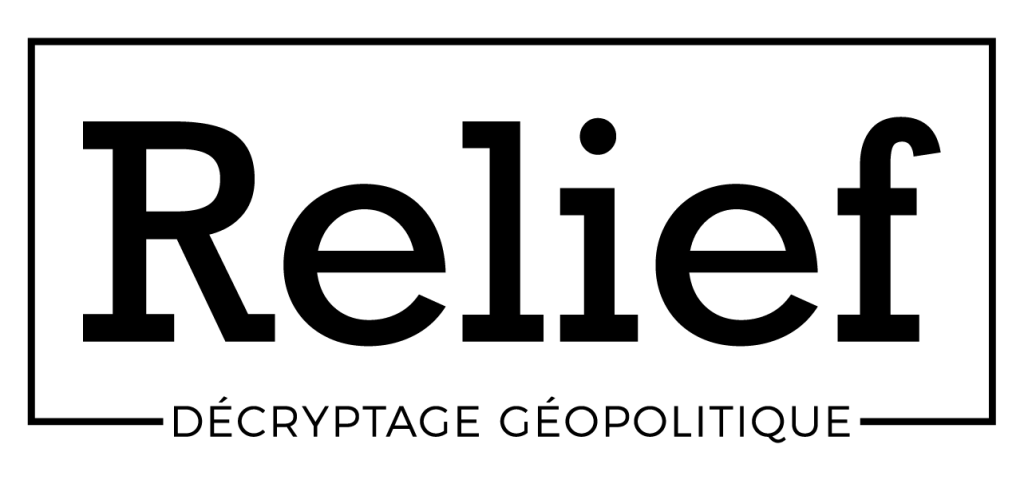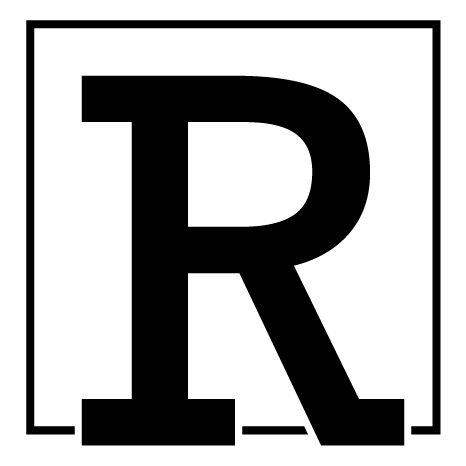L’épineux mariage d’Athènes avec le FMI en matière de sauvetage
Nous sommes le 17 avril 2010 et l’Eyjafjallajokull, en Islande, vient d’entrer en éruption, dégageant d’énormes nuages de cendres qui perturbent largement le trafic aérien dans certaines régions d’Europe.
À Athènes, le gouvernement grec se préparait anxieusement à la première visite des chefs de mission de ses créanciers : s’ils ne signaient pas un prêt, la Grèce ferait faillite dans un mois. Le temps étant compté, les équipes de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne ont dû faire le voyage de Bruxelles en bus. Le seul fonctionnaire qui est arrivé à temps pour la réunion prévue est le chef de mission du Fonds monétaire international, Poul Thomsen, qui est venu en avion de Washington.
Cet incident a peut-être été le signe avant-coureur du rôle central que l’économiste danois allait jouer dans l’évolution économique et politique de la Grèce au cours de la décennie suivante, dans un chapitre de l’histoire qui s’est achevé avec l’annonce par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis de la fermeture du bureau du FMI à Athènes le mois dernier.
M. Thomsen est né en 1955 dans une petite ville danoise proche de la frontière allemande. Il a étudié l’économie à l’université de Copenhague et a failli être refusé lorsqu’il a postulé au FMI parce qu’il n’avait pas de doctorat. Mais lorsque la crise grecque a éclaté, il travaillait au Fonds depuis 30 ans et avait également été chargé du sauvetage de l’Islande en 2008, ce qui faisait de lui l’homme idéal pour le poste en Grèce. Ambitieux et travailleur, et surnommé par ses collègues “le gars de la crise”, M. Thomsen était plus dans son élément dans les pays au bord de l’effondrement économique que lors des réunions du FMI à Washington.
Pour le directeur du Fonds de l’époque, l’économiste français Dominique Strauss-Kahn, participer au sauvetage d’un État membre de l’Union européenne était important. Il savait que la réputation du FMI était en jeu s’il ne contribuait pas à enrayer la propagation de la crise dans la zone euro. La chancelière allemande Angela Merkel était également convaincue que le Fonds devait faire partie de la solution en offrant son savoir-faire.
“La vérité est que la plupart d’entre nous ignoraient à quel point l’Europe n’était pas préparée à une telle entreprise”, se souvient Thomas Wieser, ancien président du groupe de travail de l’Eurogroupe (EWG) et principal architecte des programmes de sauvetage de la zone euro.
Les premières fois qu’ils se sont assis ensemble, les membres des missions en Grèce ont considéré M. Thomsen comme juste et raisonnable – peut-être même plus que ses collègues européens – et comme ayant des objectifs plus réalistes à l’esprit. “Il a réussi à faire passer l’objectif de déficit de 13 % en 2010 à 3 % sur cinq ans au lieu de quatre, comme convenu à l’origine”, se souvient le ministre grec des finances de l’époque, George Papaconstantinou.
La première revue des performances a été achevée à l’été 2010 dans les délais impartis et les institutions ont semblé satisfaites de la réponse des autorités grecques. Le conseil d’administration du FMI s’est toutefois inquiété du fait que la dette du pays n’était pas vraiment viable – l’une des principales conditions de la participation du Fonds – et a maintenu la pression. Ce qui était évident, c’est que les Grecs allaient devoir respecter un plan strict pour convaincre les marchés que le pays était sur la voie du redressement. Les prévisions initiales se sont rapidement révélées beaucoup trop optimistes.
Quelques mois plus tard, Mme Merkel et le président français Nicolas Sarkozy ont annoncé que tout futur plan de sauvetage comprendrait désormais une “décote” de la dette privée. Les marchés, quelque peu portés par la réussite du premier examen de la Grèce, ont reculé devant cette nouvelle. Les représentants des créanciers se souviennent de la pression exercée sur le gouvernement grec pour qu’il fasse un grand geste qui impressionnerait les marchés, sur l’insistance de Thomsen. Peu après, le Fonds a annoncé que la Grèce allait privatiser 50 milliards d’euros d’actifs publics. Cet objectif s’est rapidement avéré intenable, portant un coup à la crédibilité de Thomsen.
Pratiques “immorales
L’élection d’Antonis Samaras au poste de Premier ministre en juin 2012 a marqué le début d’une période de tensions intenses entre Thomsen et le gouvernement grec, mais aussi la Commission européenne. À ce moment-là, les Européens avaient acquis le savoir-faire nécessaire pour gérer le programme par eux-mêmes et étaient devenus sceptiques quant aux recettes politiques du FMI, mais un manque de confiance dans les institutions européennes de la part de pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas a rendu le départ du Fonds impossible, renforçant la position de Thomsen.
Une dispute entre les représentants des institutions précéderait presque chaque réunion avec leurs partenaires grecs, car les Européens avaient des projections beaucoup plus optimistes sur les performances budgétaires du pays et citaient les progrès qu’ils voyaient comme preuve. “Il y avait deux phases dans chaque négociation : l’une avec les Européens et l’autre avec les Grecs”, explique un fonctionnaire du FMI qui a refusé d’être nommé.
Thomsen, quant à lui, avait fini par comprendre que Berlin était la véritable force derrière l’Eurogroupe et s’est rendu en Allemagne à plusieurs reprises, souvent secrètement, afin de renforcer sa relation avec Wolfgang Schaeuble, alors ministre des finances. Sa fermeté à l’égard de la Grèce a rapidement conquis le fonctionnaire allemand et les deux hommes ont entamé une relation mutuellement bénéfique. Le sceau d’approbation du FMI a permis à Schaeuble de faire passer les décisions relatives au programme grec au Bundestag, tandis que Thomsen a bénéficié du soutien du ministre le plus puissant de la zone euro. Ce qui semble avoir uni les deux hommes, c’est une profonde suspicion réciproque quant à la capacité de la Grèce à se réformer.
Le scepticisme de l’économiste danois provenait du fait qu’il avait vu comment légiférer et mettre en œuvre des réformes étaient deux choses totalement différentes en Grèce. Les lois peuvent être adoptées par le Parlement, mais les intérêts particuliers trouvent toujours une faille qui leur permet de continuer comme si de rien n’était. Les privatisations ont été retardées, les professions fermées sont restées inaccessibles, les amnisties fiscales ont continué, et ainsi de suite.
L’insistance de Thomsen sur les licenciements dans le secteur public a été la principale épine dans sa relation avec le gouvernement grec. Il pensait que la menace de licenciement rendrait les fonctionnaires plus efficaces. Mais comme la Constitution grecque interdisait les licenciements généraux, Thomsen a exigé que des organisations entières soient fermées pour que le pays puisse atteindre ses objectifs. Le fonctionnaire du Fonds admet que Thomsen a utilisé l’une des tactiques de négociation les plus dures du FMI : Proposer quelque chose d’extrême dont vous ne vous souciez pas vraiment, afin de pouvoir l’échanger plus tard ou l’utiliser comme levier contre l’autre partie. Certaines personnes au FMI “trouvaient cette pratique immorale, mais Thomsen était prêt à l’utiliser”, explique le fonctionnaire.
Sous une pression énorme, le gouvernement grec a fermé le radiodiffuseur public ERT en juin 2013, une décision qui a provoqué le départ de la Gauche démocratique du gouvernement tripartite et menacé la coalition. “L’hégémonie technocratique de Thomsen était devenue une obsession technocratique. Son insistance sur les licenciements a gâché l’élan réformateur, et ce sur une question taboue qui n’avait pas de réelle valeur ajoutée”, note Stavros Papastavrou, l’un des principaux négociateurs du gouvernement Samaras, qui s’était violemment opposé au chef de mission du FMI. Les licenciements dans le secteur public n’ont pas été remis sur le tapis lors des négociations qui ont suivi la fermeture de l’ERT.
Les finances de la Grèce avaient commencé à montrer des signes clairs d’amélioration à la mi-2013, et pourtant Thomsen “est devenu encore plus dur et plus pessimiste dans ses prédictions”, selon l’ancien ministre des finances Yannis Stournaras. L’explication que certains donnent est que le FMI avait commencé à perdre son rôle de vedette dans le programme grec.
La menace du Grexit
La Commission européenne a changé trois fois de président au cours de la présence de M. Thomsen en Grèce. Certains collègues de l’économiste danois affirment qu’il s’est trop impliqué dans le programme grec et qu’il est devenu obsédé par certaines réformes, notamment celles de la sécurité sociale et du travail. Son attitude a également semblé mettre en colère les Grecs ordinaires, à tel point qu’il a été assailli un jour devant le ministère des Finances, dans le centre d’Athènes, par un homme qui lui a jeté des pièces de monnaie et proféré des injures. “Pourquoi me détestent-ils plutôt que les Européens ?” aurait-il demandé à ses collègues, alors que beaucoup le décrivent comme particulièrement sensible aux critiques.
En avril 2014, la Grèce a fait sa première incursion sur les marchés depuis le début de la crise ; son déficit s’était réduit de 8,9 % à l’été 2012 à 3,6 %, tandis qu’une contraction économique de 9,1 % s’était transformée en une croissance de 0,7 %. Un examen des performances qui avait traîné pendant cinq mois a finalement été bouclé, mais a laissé des cicatrices indélébiles dans la relation entre Athènes et le FMI.
C’est alors que Thomsen a commencé à évoquer la possibilité d’une sortie de la Grèce de l’euro au sein du Fonds. “Ce pays ne peut pas être réformé”, se souvient-il. “Peut-être est-il préférable qu’il quitte l’euro”, a-t-il ajouté, arguant que le système politique grec était corrompu et que les liens clientélistes étaient trop profondément ancrés pour pouvoir être changés.
La démission d’Haris Theocharis du poste de secrétaire général aux recettes publiques en juin 2014 a contribué à renforcer les affirmations de Thomsen sur la Grèce et le manque de volonté du gouvernement à se heurter aux intérêts particuliers et à combattre la corruption.
L’examen crucial
Samaras savait qu’il lui restait encore un examen pour terminer le programme et juste assez de temps pour élire un président grec. “Nous allons boucler celui-ci rapidement”, a-t-il déclaré aux institutions à l’été 2014. Il n’avait pas tenu compte de la fatigue des réformes qui assaillait le gouvernement, ni de l’incompréhension totale du FMI face à son besoin de précipitation.
Même si Thomsen a été promu en juillet à la tête du département européen du Fonds, son successeur en tant que chef de mission pour la Grèce, Rishi Goyal, était tout ce qu’il pouvait souhaiter, selon des personnes qui les connaissaient bien tous les deux : un technocrate soucieux du détail qui jouerait le rôle de mauvais flic et qui voulait que le FMI maintienne sa position inflexible. On dit aussi qu’il était convaincu que la Grèce n’avait pas sa place dans la zone euro. Thomsen n’était peut-être plus dans la salle, mais sa présence était plus forte que jamais.
Non seulement l’évaluation des progrès de la Grèce n’a pas été rapide, mais elle n’a jamais été achevée. D’une part, Thomsen a déclaré qu’il n’avait aucune raison de retourner à Athènes, puisque la Grèce n’avait achevé qu’une seule des 14 réformes structurelles exigées pour mener à bien l’évaluation. De l’autre, les Grecs et les Européens ont insisté sur le fait que les différences entre les deux parties étaient légères et pouvaient être comblées.
Le même fonctionnaire du FMI raconte à Kathimerini que le Fonds a évité de faire des propositions spécifiques de ce qu’il attendait des Grecs pour relancer les négociations, tandis que le gouvernement grec était trop lent à montrer qu’il était prêt à adopter les mesures douloureuses nécessaires pour conclure la révision. En décembre 2014, la différence entre les calculs des deux parties s’était réduite à seulement 1,6 milliard d’euros, mais les responsables du FMI refusaient toujours de venir à Athènes pour discuter, malgré les supplications du gouvernement grec.
Désespérant de trouver une solution, Samaras avait appelé le secrétaire américain au Trésor Jack Lew fin novembre 2014 et lui avait demandé d’intervenir pour que les négociations avec le Fonds puissent reprendre. Le plus gros problème, a-t-il appris, était une absence de confiance dans le gouvernement grec, car Thomsen pensait que Samaras avait perdu la capacité de poursuivre les réformes. “Thomsen m’a donné l’impression que son problème avec la Grèce était devenu personnel”, se souvient un fonctionnaire américain.
L’élection présidentielle grecque n’était alors plus qu’à trois mois de distance et, sans rien à montrer, Samaras était incapable de lutter contre la popularité croissante du leader de gauche SYRIZA, Alexis Tsipras. Le paysage politique grec changeait rapidement, et la probabilité d’un gouvernement SYRIZA était de plus en plus grande. Pour Thomsen, la situation était claire : pourquoi lancer une bouée de sauvetage à un gouvernement qui semblait sur la voie de la sortie ? Une fois l’examen terminé, la Grèce recevrait 7,2 milliards d’euros, ce qui signifierait que Tsipras retrouverait les caisses de l’État pleines et serait en mesure de tenir certaines de ses promesses anti-mémorandum.
Le mieux que Thomsen pouvait faire était d’attendre et de voir comment les développements politiques allaient se dérouler. Ce faisant, il a sapé les efforts du gouvernement Samaras et de la Commission européenne, qui souhaitait ardemment combler les différences entre les partis. “Thomsen a probablement vu l’élection de SYRIZA comme une expérience sociale, se demandant ce qui se passerait si un parti de gauche radicale arrivait au pouvoir”, a déclaré un fonctionnaire européen qui a refusé d’être nommé.
SYRIZA a été élu en janvier 2015. La position du FMI est toutefois restée tout aussi perplexe au cours des premiers mois de pourparlers. “Ils changeaient sans cesse les objectifs que nous devions atteindre”, raconte un membre de l’équipe de négociation de SYRIZA à l’époque. “C’était comme s’ils ne voulaient pas d’une percée”, ajoute-t-il, notant que le manque de confiance était palpable.
À l’approche du référendum du 5 juillet 2015, la Grèce est devenue la première nation développée dans les 72 ans d’histoire du FMI à renier ses engagements. Le 30 juin, elle a rejoint la catégorie des pays qui n’avaient pas payé leur dette au Fonds, aux côtés du Zimbabwe, du Soudan et de la Somalie. Le FMI a pris une décision surprenante et controversée juste au moment où les campagnes pré-référendaires battaient leur plein, en publiant une analyse de la viabilité de la dette du pays et en montrant que la Grèce avait désespérément besoin d’un rééchelonnement, trois jours seulement avant que les Grecs ne se rendent aux urnes. Le FMI plaide depuis longtemps en faveur d’un allégement de la dette du pays, mais la publication d’un document aussi explosif à un moment aussi crucial a été considérée avec une certaine suspicion, même par les fonctionnaires européens les plus cyniques. Les responsables du FMI justifient cette décision en disant qu’elle était obligatoire.
Les relations entre le FMI et Athènes ont changé après le référendum et après que Delia Velculescu a succédé à Goyal au poste de chef de mission. L’économiste roumaine a contribué à débloquer les négociations et à obtenir un accord en juillet 2015, se souvient un responsable grec. Le dégel, cependant, n’a pas duré longtemps.
En effet, en 2017, la partie grecque avait le sentiment que le FMI avait perdu tout intérêt pour le pays. La vérité est que, de l’été 2014 à la fin du programme en 2018, le FMI n’a pas déboursé un seul euro à la Grèce, mais il a continué à jouer un rôle actif dans le programme.
“C’était un sacré exploit et c’est principalement à Thomsen, qui est aussi brillant que machiavélique”, déclare un autre fonctionnaire européen sous couvert d’anonymat.
Poul Thomsen a décliné les nombreuses demandes de commentaires de Kathimerini.