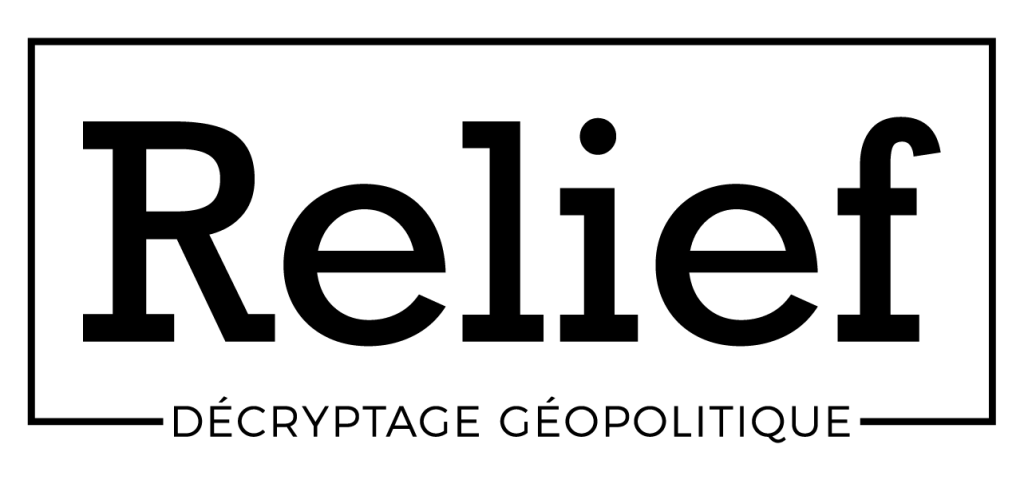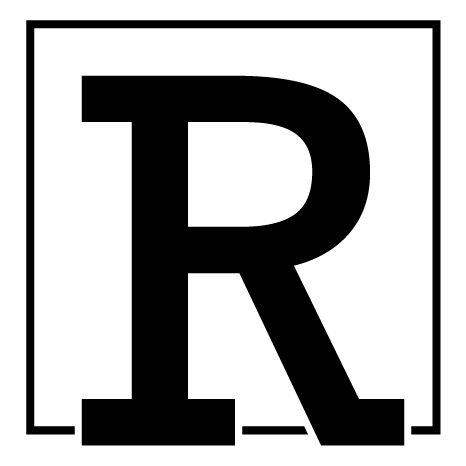C’est en douceur que s’ouvre la cinquième édition de “Greater New York”, l’exposition de MoMA PS1 consacrée à l’art réalisé par des personnes vivant et travaillant à New York. Cette édition, comme la précédente, va au-delà des tendances de l’art contemporain, avec un nombre notable de reconsidérations ou de redécouvertes d’artistes disparus, ce qui donne du poids et du sérieux à la thématique. Occupant deux étages, avec deux installations vidéo supplémentaires cachées au sous-sol, “Greater New York” se déploie lentement pour une exposition qui présente un barrage de plus de 200 œuvres. C’est le résultat d’un commissariat réfléchi et sensible, dirigé cette année par Ruba Katrib.
Dans l’une des premières galeries du deuxième étage, les peintures stylisées et texturées de la flore de Nadia Ayari font écho aux couleurs des photographies adjacentes d’Avijit Halder. L’œuvre de Halder est autoréférentielle et autobiographique : des hommes s’enveloppent et agitent des saris qui appartenaient autrefois à la mère de l’artiste, morte violemment dans un bordel de Kolkata, nous apprend un texte mural. Les saris, qu’Halder a emportés avec lui de l’Inde aux États-Unis après la mort de sa mère, volent et ondulent, s’enroulent autour du corps d’Halder et d’autres personnes, le tout dans une exploration du genre, de sa performance et de l’identité non-binaire d’Halder. Les photographies exorcisent également le chagrin et commémorent la vie de sa mère.
L’œuvre pourrait reposer entièrement sur ces détails autobiographiques, sauf que les photographies sont également magnifiques : les riches couleurs des saris, la légère surexposition de certains cadres, la composition précise. Tout près, les peintures d’Ayari, aux textures tout aussi riches et aux bleus, roses et verts éclatants, sont accrochées, comme pour dire à propos d’Halder : voici un artiste qui fait de l’art, pas simplement quelqu’un qui raconte une histoire triste. C’est un rappel utile, mais qui demande du temps – du temps dans la pièce, du temps avec les peintures, du temps avec les photographies – pour le recevoir pleinement.

Les récits personnels, l’autobiographie et l’autoréférence abondent dans les pratiques artistiques contemporaines, et les histoires de luttes et de conflits personnels semblent presque nécessaires pour conférer à une œuvre d’art le sérieux requis pour être exposée dans un musée. Ce n’est pas qu’il n’y ait rien de tout cela dans “Greater New York” – en fait, il y en a beaucoup – mais les œuvres ne s’appuient pas sur les luttes qu’il a fallu mener pour les produire pour prétendre à une substance artistique.
Des thèmes suivent les spectateurs comme des fantômes amicaux, donnant à l’ensemble de l’exposition un sentiment de cohésion désinvolte. La crise du sida et la vie des homosexuels dans le New York des années 70 et 80 apparaissent directement dans la biographie de nombreux artistes, mais aussi de manière plus subtile dans certaines pièces, comme Maternal Milk de Rotimi Fani-Kayode, de Rotimi Fani-Kayode, une photographie en noir et blanc d’un homme noir assis sur le sol, recroquevillé sur lui-même, tandis qu’un liquide blanc laiteux coule sur son dos, et dans les photographies d’Andreas Sterzing de l’artiste et militant du sida David Wojnarowicz, du peintre et sculpteur Luis Frangella (mort de complications liées au sida en 1990) et de l’artiste conceptuel Mike Bidlo.

Les peintures de Frangella sont également disséminées au troisième étage, un immense portrait sans nom dans la galerie principale, auquel fait écho un portrait provocateur de Wojnarowicz, dans lequel une représentation à larges traits du visage de l’artiste apparaît de part et d’autre d’un morceau de carton plié en forme de tente. Les liens sont visibles mais pas didactiques, laissant aux spectateurs la possibilité de les tracer eux-mêmes.
Dans cette même grande galerie du troisième étage, une vidéo de deux minutes réalisée par le poète Bob Holman
pour Poetry Spots, une série de courtes vidéos diffusées entre des segments sur WNYC-TV de 1987 à 1995, montre Diane Burns récitant son poème “Alphabet City Serenade”. Diane Burns, d’origine Chemehuevi et Anishinaabe, récite des vers tels que “I’m American royalty / walking around with a hole in my knee” et “I’m a hopeful Aborigine / trying to find a place to be” d’une voix chantante sur des images de l’East Village et du Lower East Side.
À 30 secondes de la fin du clip, elle apparaît devant la caméra, regardant directement dans l’objectif alors que sa voix passe de chantante à déclarative :
Do you know that I hate Doris Day?
I hate Chevrolet.
I hate Norman Bates.
I hate the United States.
———————–
The piece’s last line lands poignantly in our present-day context:
———————–
Oh, you wanna talk about gentrification?
La vidéo de Burns n’est pas sa seule œuvre exposée, mais c’est la plus incontournable, son son en boucle remplit la galerie du troisième étage et fait écho à d’autres pièces qui traitent également de l’indigénéité et du mauvais traitement systémique des Amérindiens par le gouvernement des États-Unis, comme les œuvres multimédias de G. Peter Jemison, qui incorporent des objets ayant une signification personnelle et culturelle : sacs en papier, parasols, tissu du traité, perles de calicot.
Tout au long de “Greater New York”, les pièces qui abordent des thèmes similaires traversent le temps et la géographie, ainsi que l’espace de la galerie, mettant en évidence les contextes plus larges qui font que les œuvres individuelles résonnent indépendamment du moment où elles sont vues.

Dans l’un des moments forts de l’exposition, sur le mur adjacent à Poetry Spots, l’œuvre de Yuji Agematsu intitulée zip : 01.01.20 … 12.31.20, 2020 présente des objets trouvés disposés à l’intérieur de 366 emballages de cellophane de cartouches de cigarettes, un pour chaque jour de l’année 2020.
Voici un énorme paquet de chewing-gum jauni appuyé sur un petit morceau de verre, voici un petit bouton de rose rose qui sèche à côté de quelques débris, voici une boucle de fil à broder tachée d’on ne sait quoi, voici un bâton de cannelle. Ce n’est pas le fait qu’ils aient été collectés, ni même le fait qu’ils aient été acquis au cours de la pandémie, ni même la diligence qu’il a fallu pour collecter et disposer ces objets chaque jour pendant un an, qui en fait de l’art. C’est l’arrangement délibéré de ces minuscules sculptures, chaque emballage en cellophane contenant une composition minutieuse. Enlevez un élément, et il redevient un déchet.

Dans “Greater New York”, le contexte de la ville physique apparaît à la fois indirect et indispensable à la pratique des artistes. Une paire de sculptures récentes de Kristi Cavataro en est un exemple. Leurs vitraux colorés et soudés prennent des formes qui rappellent l’infrastructure de la ville – poteaux d’éclairage, grilles de rues, barres de fer forgé au-dessus des fenêtres. Voici à nouveau la ville de New York, disent les pièces, sous des formes apparemment infinies.
Cela est dû en partie au fait qu’elles sont placées près de photos d’Hiram Maristany, qui a été le documentaliste officiel de la section new-yorkaise du Young Lords Party. Un mur de ses œuvres datant des années 1960 met en évidence l’action dynamique dans les rues, avec des gros plans sur des vestes hérissées d’épingles politiques, un groupe de manifestants s’emparant d’un camion portant l’inscription CHEST X-RAY UNIT ou un groupe de jeunes femmes assises sur les marches.

C’est un soulagement de voir des pièces qui jouent bien les unes avec les autres, tant sur le plan thématique qu’esthétique. Et si tous les thèmes que l’on attend d’une exposition de cette taille et de cette envergure sont présents, ils ne sont pas pour autant assommants. Les œuvres exposées sont souvent personnelles, d’une manière qui leur donne une large résonance sans perdre leur spécificité bien pensée. Les peintures de Frangella, par exemple, portent autant sur la crise du sida et la vie des homosexuels à New York que sur des thèmes plus larges comme le deuil, la perte et le caractère inévitable de l’amitié et de la mort. La récurrence des œuvres dans les galeries nous incite à nous demander à qui nous nous attachons et pourquoi nous le faisons.
L’exposition est vaste, aussi ces points de contact thématiques – qui prennent la forme de peintures de Frangella ou de sculptures de Cavataro lorsqu’elles réapparaissent au troisième étage – donnent aux visiteurs un sens de l’orientation et un ensemble de lignes directrices à suivre au fur et à mesure qu’ils avancent. Le commissariat utilise efficacement les différentes tailles des galeries, les grandes salles présentant une variété presque vertigineuse tandis que les petites salles se rapprochent d’un seul thème conceptuel ou esthétique.

L’un des favoris de cette dernière catégorie se trouve dans une petite galerie du troisième étage, où des dessins de Milford Graves illustrant ses recherches sur les effets du son et de la musique sur le corps humain sont exposés en face d’un ensemble de quatre œuvres de Rosemary Mayer qui retracent les bruits entendus par l’artiste sur différents laps de temps. Chacun des diagrammes colorés au pastel de Mayer est inscrit avec désinvolture dans les marges des papiers – elle entoure ou écrit le nom du bruit dans la couleur correspondante – boum encerclé en magenta, claquement en corail cursif, gémissement ocre, sirène violette. Les œuvres, qui sont le résultat de l’écoute de Mayer pendant un mois ou un quart d’heure seulement, témoignent de tout ce qu’une seule minute de New York peut contenir.
Cette impression de profondeur de la ville, de chaos permanent dans lequel il faut se débattre, sert à la fois de contexte et de nourriture pour les artistes dont les œuvres sont exposées dans cette exposition. Il y a tellement de choses à prendre dans le quotidien que la responsabilité de l’artiste consiste à y mettre de l’ordre, à l’arranger, à lui donner un sens. La conviction passionnante qui semble sous-tendre l’exposition “Greater New York” de cette année est que le spectateur peut faire de même.